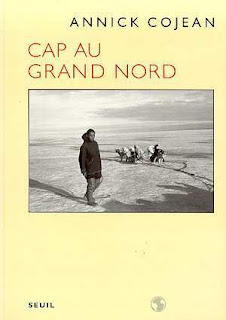Je viens de lire un grand livre. Un livre bien écrit, violent, sensitif. Un livre nécessaire, et pas seulement en son temps. Ça s'appelle Les Enfants de l'Oncle Tom et c'est écrit par Richard WRIGHT, écrivain Afro-Américain, artiste Noir exilé à Paris aux temps où l'Amérique était ségrégationniste et où Paris passait pour une terre d'accueil. Un temps lointain et proche.
Le roman se compose de trois épisodes de la vie dans le Sud. Dans le premier épisode intitulé « Le Feu dans la nuée », révérend Taylor est un Noir obéissant, pacifiste et raisonnable. Il s'entend assez bien avec le Maire blanc, qui lui parle comme à un enfant. Jusqu'au jour où les industriels (blancs) du pays font pression sur le Maire pour empêcher une manifestation des ouvriers noirs, qui meurent de faim. Le Maire fait la morale au révérend : il faut qu'il persuade ses ouailles qu'il vaut mieux mourir de faim en silence que de manifester dans le centre ville des Blancs. Taylor ne promet rien. Alors des hommes blancs l'enlèvent, l'emmènent à quelques kilomètres de la ville, l'attachent à un arbre et le fouettent jusqu'à ce qu'il tombe inconscient, baignant dans son sang. Taylor revient en ville pendant la nuit, traversant les banlieues blanches respectables. Il rejoint son home, honteux et presque mort. Le lendemain, il apprend que d'autres Noirs ont été châtiés. Devant la foule de Noirs prêts à défiler, il prend enfin sa responsabilité : il faut défiler et il faut être nombreux. Le cortège arrive en ville, choquant les bourgeois et les bourgeoises. Le Maire fait appeler Taylor au milieu du cortège, mais cette fois Taylor renvoie le messager et fait dire au Maire que c'est à lui de se déplacer. La liberté appartient aux forts.
Dans « Le Départ de Big Boy », quatre adolescents sèchent l'école par un jour de chaleur pour aller se baigner dans une mare privée, qui appartient à un blanc. Ils laissent leurs habits au pied d'un arbre et vont se rafraîchir, s'amuser, chanter. Une Blanche arrive et les regarde un peu effrayée. Deux des jeunes Noirs ont un mauvais mouvement : ils se dirigent vers l'arbre pour récupérer leur habits et déguerpir sans faire d'histoire. Mais la jeune Blanche, les voyant venir vers elle beaux et nus, réagit comme si on l'agressait (ce qu'elle désirerait peut-être) et hurle. Un blanc sort de la maison avec sa carabine et sans rien dire abat les deux garçons à bout portant. Les deux autres se jettent sur lui. Big Boy attrape le fusil, menace le Blanc, mais le Blanc avance vers lui alors Big Boy tire et tue le Blanc. La suite de l'histoire est une traque nocturne. Big Boy se terre dans un trou, son copain se fait attraper. Les notables blancs lui déversent sur la tête une marmite de goudron porté à ébullition, puis il le recouvrent de plumes et allument le feu.
Dans « Long-Chant-Noir », une jeune maman noire attend son homme à la maison. La maison en question est une ferme, c'est le fruit du travail acharné de l'homme noir pour bâtir son destin comme un Blanc. Un commis voyageur arrive à la tombée du jour, blanc-bec qui vend des pendules et des phonographes pour payer ses études dans le Nord. Il abuse d'elle, elle consent à être abusée parce que délaissée à la maison par un homme qu'elle admire mais n'aime pas, elle rêve encore de son grand amour de jeunesse, parti à la guerre et jamais revenu. Avant le petit matin le jeune Blanc repart : il laisse le phono derrière lui et promet de repasser le lendemain. Le fermier noir revient chez lui, trouve le phonographe posé dans la chambre. Combien cela vaut-il ? Quarante dollars. L'étiquette dit cinquante... Il chasse sa femme et son enfant, qui vont se réfugier dans les bois. Au matin le commis blanc revient, accompagné d'un ami. Le fermier l'accueille en lui tirant dessus. L'ami du Blanc repart à toute allure. Plus tard, les Blancs arrivent et mettent le feu à la ferme, et le fermier reste dans sa ferme, et sa femme regarde les flammes monter au ciel sans entendre ni émettre un cri.
Richard Wright est connu principalement pour son œuvre autobiographique, et particulièrement pour Black Boy et Native son (Un enfant du Pays). Indésirable aux Etats-Unis, il arrive à Paris juste après la Deuxième Guerre mondiale et est accueilli par l'équipe des « Temps modernes », Sartre et Beauvoir en tête. Il s'installe durablement en France et y finit sa vie, ce qui explique en partie le succès de ses livres ici. Aux U.S.A., James Baldwin est l'un de ses descendants littéraires, même s'il prend ses distances avec la vision de Wright sur la question des Noirs. Le public américain considère Homme invisible de Ralph Ellison comme le plus grand roman écrit par un Noir, et l'un des plus grands romans du XXè siècle. En comparaison, il fait peu de cas des romans de Richard Wright. En France, Ralph Ellison est un inconnu, même pas publié dans une collection de poche... Wright, Ellison et Baldwin sont, chacun à leur façon, trois romanciers incontournables pour quiconque s'intéresse au destin des Noirs américains au XXè siècle.
178 pages, coll. Livre de Poche - 2 € env.
Redécouvrez la Quinzaine Noire du BàL, et aussi ce livre d'Angela Davis
 Willy RONIS est un grand photographe. La plupart de ses photos sont composées dans un style plutôt classique, qui n'est pas sans rappeler les photos souvent plus célèbres de Doisneau ou de Cartier-Bresson. Ronis se distingue de Doisneau, entre autres, parce que ses photos sont plus intimes : il met souvent ses proches en scène comme dans "La sieste", photo prise dans sa maison de Gordes en 1949.
Willy RONIS est un grand photographe. La plupart de ses photos sont composées dans un style plutôt classique, qui n'est pas sans rappeler les photos souvent plus célèbres de Doisneau ou de Cartier-Bresson. Ronis se distingue de Doisneau, entre autres, parce que ses photos sont plus intimes : il met souvent ses proches en scène comme dans "La sieste", photo prise dans sa maison de Gordes en 1949.